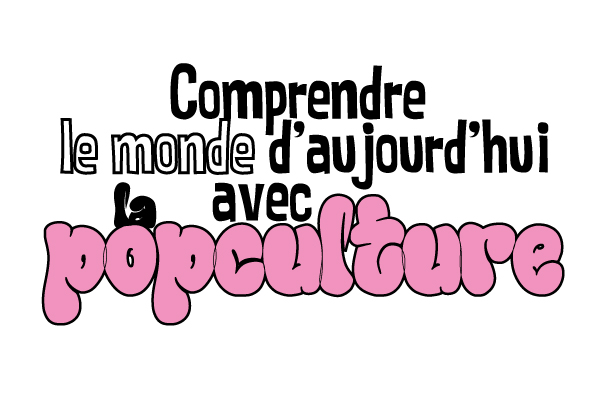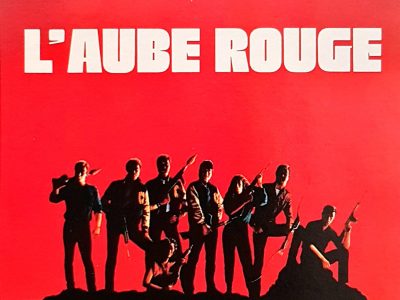Il ne faut pas sous-estimer la pop culture !
Ni pour la façon dont elle se nourrit des angoisses du moment, ni pour la façon dont elle influence les milieux que nous étudions, complotiste ou d’extrême droite.
Parmi toutes les sorties de films ou de séries ces derniers temps, certaines ont retenu notre attention. Pour ce qu’elles disent de notre époque, de nos préoccupations.
Pour commencer, rappelons ce principe :
Un film parle toujours plus du contexte dans lequel il a été conçu que son sujet. C’est valable pour les films d’époque ou la science-fiction. Un film ou une série est un récit, à ce titre, ça raconte beaucoup de choses sur notre environnement, nos affects, nos désirs, nos angoisses.
Précisons tout de même que nous parlerons de ces objets cinématographiques sans donner d’avis sur l’aspect qualitatif (ou presque). Certaines de ces productions souffrent de quelques défauts, mais l’essentiel n’est pas là.
Cet article est garanti sans spoiler/divulgâchage.
Les angoisses scandinaves en 4 séries
Ouvrons nous l’appétit avec ces séries qui nous viennent du nord. Pas de Lambersart, ni même de Charleroi… plus haut, dans les contrées froides qui ont offert au monde le gravlax, la trilogie Millenium, Ikea et une production délirante de groupes de métal. Nous arrivent de Scandinavie, ces quelques séries qui ont ce petit quelque chose de particulièrement signifiant.
Occupied
Occupied est une série norvégienne dont la première saison date de 2015. Le synopsis est plutôt classique : la Norvège développe une énergie propre. La Russie envahit le pays, le reste de l’occident ne lève pas le petit doigt, refusant de voir s’écrouler l’équilibre du monde suite à cette révolution énergétique. La série traite de la vie sous l’occupation russe, scénarisée entre autre par Joe Nesbo, auteur de polars et créateur du personnage de Harry Hole.
Si la série est la plus ancienne des trois, il est important de noter, le projet a une production sur le temps long : La première saison est diffusée en 2015,la seconde sort en 2018, la troisième en 2024. Il y a un véritable effet « avant/après » le 22 février 2022, date de début de l’offensive russe sur Kyiv.
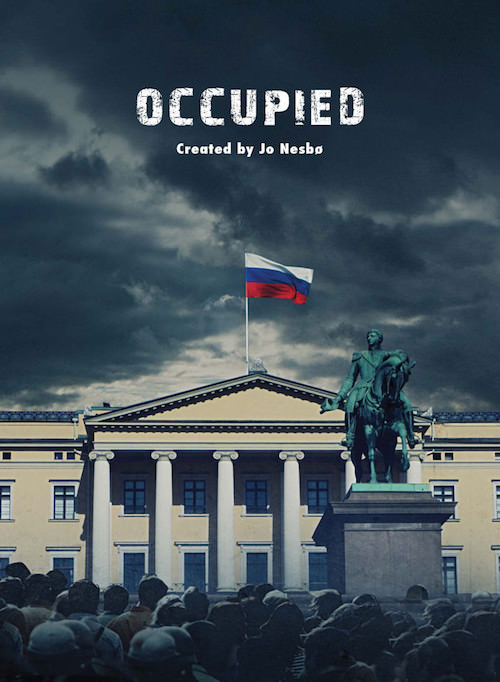
Et ça, personne ne s’y trompe. Les pays scandinaves ont une tradition de neutralité, moins affirmée que la Suisse, certes, mais les trois pays ne sont pas des puissances militaires de premier plan. Ils maintiennent une conscription, mais dans l’optique d’une défense territoriale. Le changement s’opère en 2002 quand ces pays se joignent à l’offensive contre l’axe du mal en Afghanistan.
Le récit est plus proche du thriller politique, mais le traitement est révélateur : comment un pays réagit à une invasion étrangère, mais surtout russe ? Bien évidemment, ce n’est pas flatteur pour Moscou, néanmoins, la Norvège a une frontière commune avec la Russie et la politique agressive du Kremlin ne laisse personne indifférent.
Conflict
Conflict est une série finlandaise diffusée en 2024. Le synopsis est assez proche de la précédente. Un beau jour, une force militaire prend possession de la péninsule de Hanko au sud de la Finlande. Tout au long des six épisodes, nous allons suivre différents personnages dont des militaires qui organisent la riposte bon gré mal gré et des politiques qui tergiversent.
Nous avons ici une série plutôt portée vers l’action, mais les enjeux politiques qui y sont décrits sont très révélateurs des atermoiements des politiques piégés par leur tradition pacifiste. Conflict est typiquement un produit de ce que Poutine appelle « une opération spéciale » et les appellations du genre « guerre hybride », un objet pensé à partir de la guerre en Ukraine, spécifiquement autour de la menace du voisin russe. Aku Louhimies, le showrunner de Conflict s’est même engagé à diffuser gratuitement la série en Ukraine.
1340 km de long, c’est la longueur de la frontière entre la Russie et la Finlande. Compte tenu de l’impérialisme russe, la Finlande a toutes les raisons d’entretenir des craintes, même si les relations entre les deux pays sont plus complexes qu’elles n’y paraissent.
L’idée de prendre la péninsule de Hanko ne vient pas de nul part. Pendant la seconde guerre mondiale, alors que l’Allemagne envahissait l’Europe, la Finlande se prend les armées de Staline sur la tronche. Pour tenir face à l’ennemi soviétique, le pays fera appelle aux nazis, entraînant la déclaration de guerre des britanniques, etc. La bataille de Hanko en 1941 était déjà le terrain des forces soviétiques voulant annexer, tout ou partie, la Finlande.
Un personnage important
L’un des personnage centraux de la série est la présidente finlandaise. Difficile de parler d’elle sans spoiler, néanmoins il est impossible de ne pas penser à l’ancienne première ministre du même pays Sanna Marin, défaite aux législatives de 2023 face à une coalition des conservateurs… et de l’extrême droite.
Coalition qui a mené une campagne à charge contre elle, contre sa sortie de la neutralité du pays, mais aussi en instrumentalisant une fête à laquelle elle a participé et où de la drogue y aurait été consommé.
The fortress
The fortress est une autre série norvégienne, diffusée en 2023. Durant 7 épisodes, nous allons être projeté dans une Norvège isolée derrière un mur pour se protéger d’un virus. Le pays se retrouve face à un afflux de réfugiés qui cherchent une vie meilleure. Jusqu’à ce qu’un autre virus apparaisse, à l’intérieur ! Le mur se retourne alors contre eux.
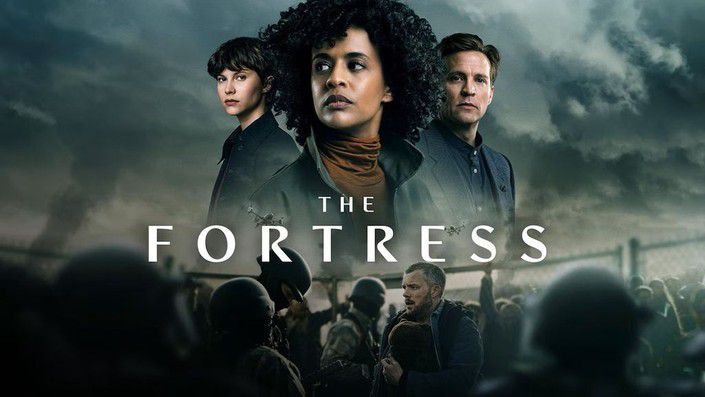
Si cette idée n’est pas née pendant le confinement… Bien sûr, The fortress fait implicitement référence à la pandémie du COVID. Oui, mais pas que. Ce n’est pas rare de voir un virus comme point de départ d’un futur dystopique dont la pop culture est friande. Toutefois, il ne s’agit ici que du point de départ de l’intrigue d’une série dont le sujet est plus l’isolationnisme et la problématique de l’immigration.
La désinformation par les réseaux sociaux, la défiance et la corruption sont d’autres thèmes de cette série. Le traitement de la thématique de l’immigration n’est pas sans rappeler une autre série, Years and years, qui joue sur la prospective, un scénario d’anticipation sur l’Angleterre post-Brexit.
Family like ours
Family like ours est une série danoise de 2024 dont le showrunner et réalisateur est Thomas Vinterberg, celui là même qui a commis le rigolard Festen en 1998. Le synopsis rappelle un peu la série précédemment citée, dans son caractère anticipateur. Les eaux montent drastiquement, le Danemark n’a pas les moyens financiers de protéger le pays, les Pays Bas n’ont pas réussi. Alors les autorités décident d’évacuer le pays, mettant des millions de citoyens dans une situation de réfugiés.
Avec Family like ours, le co-fondateur du Dogme95 explore les thèmes du réchauffement climatique, de la crise du capitalisme et du statut de réfugié, avec la petite touche du chef, les familles dysfonctionnelles. Plus de dix ans après avoir vu le flot de réfugiés fuyant la Syrie et les réactions politiques d’Europe, en particulier la montée des partis xénophobes, le narratif est limpide : ça pourrait aussi nous arriver. Et on aura l’air fin.
Là encore, la guerre en Ukraine n’est pas glissée sous le tapis, et la lecture de ce récit, à la lumière du contexte de sa création nous donne cette conclusion de partie : la guerre, que l’on pensait lointaine, s’est rapprochée de nous. Ces séries montrent que nous avons tous très bien intégré ce que ça implique. Conscient ou nous, c’est là. Et c’est le caractère populaire de la pop culture qui est ici mis en avant, nous parlons de produits culturels diffusés à grande échelle (tout étant relatif, nous parlons ici de culture européenne).
La pop culture aux USA
Il y aurait tant à dire sur l’importance de la pop culture dans l’imaginaire américain. Évitons de nous éparpiller. Nous allons ici nous concentrer sur un film récent, même si l’exercice pourrait être reproduit à chaque sortie. Comment Avengers raconte-t-il notre époque ? Peut être l’occasion d’un autre article.
Aujourd’hui, nous allons parler de Civil War.
Civil war et le Capitole
Civil war est un film américain réalité par le britannique Alex Garland, compère de longue date de Danny Boyle. Un Road movie assez classique sur la forme qui suit des reporters de guerre… dans une Amérique en proie à une guerre civile.
Nous avions parlé de l’influence de la pop culture sur les assaillants du Capitole. Et en voyant le film, on ne peut pas s’empêcher d’y penser : c’est évident, c’est la base du film ! Sa genèse se trouve là. Et pourtant, Alex Garland bat l’idée en brèche.
« Les raisons qui président à la date de sortie d’un film sont complexes et il faut s’appeler Spielberg ou Nolan pour avoir le dernier mot sur ce genre de choses. Je vois néanmoins à quel point tout cela semble planifié et intentionnel. Mais il faut savoir que j’ai écrit ce film il y a longtemps, en juin 2020, soit sept mois avant l’assaut du Capitole. […] Quand j’ai vu les images de l’assaut du Capitole, alors que le film était déjà écrit, je ne me suis pas dit que j’avais été particulièrement inspiré, car tout ça était déjà dans l’air. D’ailleurs, vous avez peut-être réagi comme moi : vous avez été choqué, mais avez-vous vraiment été surpris ? »
Alex Garland : « J’ai écrit Civil War avant l’assaut du Capitole » – Première
Effectivement, ce n’est pas comme si les ingrédients n’étaient pas déjà là avant. Le 6 janvier 2021 a été une surprise parce que ce passage à l’acte était surprenant, pourtant les discours préalables nous inquiétaient déjà. L’élément déterminant a été la prise de parole de Donald Trump. Il est directement responsable des morts et blessés de ce jour là.
Les personnages sont peut être caricaturaux, mais l’idée que des milices, les mêmes qui professent la guerre civile depuis des années, passent à l’acte, ce n’est pas inintéressant. Vu les évènements du Capitole, ce type de prospective ne devrait pas être prise à la légère dans un pays qui regorge d’armes et à l’histoire si particulière.
Manhunt
Bien entendu, le concept même de guerre civile est profondément ancré dans la culture américaine. N’importe qui regarde les productions US connaît la bataille de Gettysburg (1863) par exemple, moment déterminant de la guerre de sécession (1861-1965).

La mini-série commence par l’assassinat de Lincoln, le reste de la série retrace les douze jours de la traque du meurtrier, John Wilkes Booth. Adaptation du roman de James L. Swanson (un libertarien qui travaille avec la fondation American Heritage, think tank qui a conçu le programme de Trump en 2024), Manhunt est adaptée par Monica Beletsky, qui avait officié comme scénariste sur les séries The leftovers et Fargo, une drôle de rencontre entre deux mondes. La volonté de Beletsky va vers une représentation « plus inclusive« , pas loin du wokisme…
Cette histoire a déjà été adaptée de nombreuses fois par le passé, mais lancer ce projet en 2022, après le premier mandat de Donald Trump est très signifiant. L’assassinat de Lincoln est l’un des jalons d’une histoire de la violence politique, la série met en scène une Amérique coupée en deux, une grande défiance envers l’État, les lectures conspirationnistes… C’est tout un imaginaire commun avec les MAGA.
L’importance du contexte
L’idée qu’une production à grand budget est dépolitisé s’est ancrée dans les esprits, conjuguée aux efforts des militants apolitiques qui ne supportent pas l’idée que l’industrie du divertissement soit vecteur de messages. « On peut pas avoir deux minutes pour souffler ? Je ne vais pas au cinéma pour parler politique. » Ça s’appelle un lieu commun, et c’est même un bon vieux poncif de droite. Oh le gros mot !? Non, l’un des principes fondateurs à gauche est de considérer que tout est politique.
Il faut ici souligner l’importance du contexte, de l’ampleur des traumas collectifs, des préoccupations des époques.
Les exemples sont nombreux.
Les héros sous stéroïdes des années 80 ? Un effet direct de l’ère Reagan.
Les théories du complot comme point central de l’intrigue ? Une conséquence du Watergate.
Et ainsi de suite…
Steven Spielberg, dans La guerre des mondes (2005), met en scène la sidération suite au 11 septembre. C’est complètement assumé.
Quand La chute du faucon noir sort en décembre 2001, son processus de production, et même le tournage étaient achevés ; bien avant les attentats du WTC. Nous sommes en plein dans les années Bush, et la résonance du message est tout autre : les USA peuvent être défait, mais l’héroïsme est toujours là. Comme dans Civil war, il ne faut pas y voir une dimension prophétique, mais plutôt un climat déjà propice à l’élaboration de ces récits.
M.A.S.H sort en 1970. La comédie se déroule pendant la guerre de Corée, mais personne n’est dupe, c’est bien de la guerre du Vietnam dont il s’agit. L’adaptation du bouquin, publié en 1968, est complètement en phase avec le mouvement pacifiste de l’époque.
L’objet pop
Quel est le point commun entre la soucoupe volante, le nazi et le zombie ? Ce sont tous des objets pop. Comprendre ici, l’objet est un sujet qui sert de support. Il est décliné film après film et selon l’époque, cristallise une menace propre à l’époque. Il faut regarder le contexte dans lequel a été produit le film pour comprendre quels imaginaires sont mobilisés au travers de ces objets.
Le zombie est un objet particulièrement plastique, qui s’adapte à son époque. Il suffit de regarder le Zombie (1978) de Romero, alors que les morts-vivants sont magnétisés par le centre commercial, allégorie de la société de consommation. Les monstres y sont lents, s’agglutinent petit à petit sur le parking. On y lit une critique du capitalisme, où le consommateur zombie, malgré le danger qu’il incarne, l’est moins que les vivants avec leurs armes.
Le remake de Snyder est un contre-pied total. Après un générique qui sous-entend une menace liée à l’islam, les protagonistes survivants deviennent héros face à des zombies rapides et ultra-agressifs. Zéro subtilité dans cette fable survivaliste, glorifiant les libertariens et la circulation des armes, à l’image de son réalisateur.
Le zombie est ici objet, servant la conception du monde de leur créateur : le premier film de Romero est de 1968 et parle de racisme, il y a une perception générationnelle. Snyder est un libertarien qui n’a jamais rien compris aux œuvres qu’il adaptait (sauf 300).
L’ennemi dans la pop culture
Il a toujours fallu représenter un antagoniste dans le récit. Utiliser des objets comme les soucoupes volantes pour parler de l’Union Soviétique était typique des 50’s. Paradoxalement, ces œuvres ont souvent permis d’appuyer le Mccarthisme. Mais beaucoup de ces films illustraient des angoisses plus générales, comme le péril nucléaire et ses mutations sur à peu près toutes les bestioles du monde.
À ce titre, L’aube rouge est un bon exemple. L’URSS s’effondre d’elle-même entre 1989 et 1991 ; la Russie n’est plus une menace en tant que super-puissance, quoique les généraux sécessionnistes pullulent pour nourrir un terrorisme anti-américain. On ne se refait pas. Alors si en 1984, l’envahisseur du film était forcément soviétique, ce n’était plus vraiment possible en 2012. La politique menée par Kim Jong-un justifie alors d’invoquer un antagoniste nord-coréen.
Même problématique pour Top Gun. En 1986, Tom Cruise affronte la chasse soviétique, via l’un de ses proxys. Ce n’est pas important, car après tout, le film n’est qu’une romance. En 2022, le même Tom Cruise qui n’a pas pris une ride affronte une autre puissance mondiale dans Top Gun Maverick. Certains y sont allés par déduction pour débusquer l’identité de l’antagoniste, il s’agirait de l’Iran. Il est intéressant de relever que dans les deux Hot Shots (1991 et 1993), parodie du premier Top Gun dans l’esprit ZAZ (pas la chanteuse), l’ennemi vient du proche Orient, à priori l’Irak, avec un pastiche de Saddam Hussein. Signe du temps.
Les russes ne sont pas en reste
Parce que les russes et le cinéma, c’est une longue histoire. Passons sur la grande histoire du 7ème Art et accélérons jusqu’à ces dernières années. La fédération de Russie a vu toute une série de films de guerre et d’invasions d’extra-terrestre. Tout du moins avant 2022 et les sanctions internationales qui ont freiné les ambitions des studios.
Dans la même veine que Independance Day, Attraction est une série de films qui montre l’invasion démarrer par Moscou. Après tout, pourquoi toujours l’Amérique ? Il y a de subtiles différences entre la mise en scène de l’héroïsme US et russe, et chacune raconte son propre impérialisme. Même analyse pour les Invasion, Sputnik ou The blackout…
Lorsque la Russie de Poutine pousse les studios à réaliser des films historiques, ce sont des reconstitutions de grandes batailles qui ont fait la gloire soviétique (Stalingrad par exemple), soutenant des narratifs en phase avec la politique étrangère du Kremlin.
Le cinéma comme catharsis
Ces récits en image nous sont utiles pour saisir l’air du temps. Ils ne sont pas neutres, ils jouent énormément dans la formulation que nous faisons des préoccupations de l’époque, livrant des éléments graphiques ou sonores, tout en prenant un peu de recul.
Alors, volontaire ou non ? Deux conceptions sont à prendre en compte :
- Le réalisateur/producteur/showrunner est conscient de ce qu’il dit. C’est le cas dans les œuvres évoquées dans cet article.
- Les tensions de l’époque ont tellement imprégné les créateurs que ça se ressent dans l’atmosphère. Et là, même le divertissement avec une volonté de neutralité politique, en dit long.
La pop culture vient à notre secours pour comprendre le récit. Nous en avions d’ailleurs parlé avec Sound of freedom, film porté par la complosphère comme contenant de grandes révélations. Film qui se révèle finalement n’être qu’un banal thriller. Parce que la façon dont les films sont perçus veulent souvent en dire autant que la façon dont ils ont été conçus.
Nous exorcisons nos peurs à l’écran, à travers ces productions accessibles à tous, permettant l’identification de chacun de nous.